Dans un réjouissant essai, moitié sérieux, moitié dérisoire, Pierre Bayard fait l’éloge, solidement argumenté, de la non lecture : aidé de Valéry, Balzac, Umberto Eco, Montaigne, Musil, David Lodge, Oscar Wilde et quelques autres, il démontre l’inconvénient de lire, de lire vraiment, de lire complètement, les livres dont on est amené à parler, aussi bien dans les conversations de salon que dans ses cours, si l’on est professeur ou surtout dans ses articles, si l’on est critique. D’ailleurs, au fond, Pierre Bayard explique même l’impossibilité absolue de la lecture au sens habituel, scolaire, exhaustif du terme et il commence son propre livre par une table déroutante d’abréviations : à côté des op. cit. et autres ibid. classiques, il propose quatre sigles recouvrant à ses yeux la totalité des situations de lecture possible : LI (livre inconnu), LP (livre parcouru), LE (livre évoqué), LO (livre oublié). Et de s’amuser, tout au long de son livre, faussement et véritablement savant, de classer ses propres références dans ces quatre catégories. C’est à la fois question de mémoire (merveilleuse évocation des trous de mémoire de Montaigne), de chic (Valéry) ou de principe (Balzac ou Wilde).
Le plus intéressant de l’affaire est la théorie de l’intersection des trois bibliothèques (la collective, la virtuelle et l’intérieure) qui structure, selon lui, le rapport imaginaire aux livres et à la culture et l’effort de déculpabilisation qu’il tente pour libérer du complexe de l’imposteur qui parle de livres qu’il connaît mal voire pas du tout. Le moins drôle est la référence plus ou moins continue à la psychanalyse qui hante, pour Pierre Bayard, la relation au livre et s’accompagne d’une sorte d’incantation à la libération de soi par l’exercice de création critique nourri de non lecture qui serait une forme de cure. On serait tenté de lui dire de renoncer à cet alibi peu convaincant et de se laisser tranquillement aller au bonheur gratuit de la lecture intermittente, clairsemée, rêveuse, amnésique, baladeuse, dont il décrit si drôlement les manières et que, en son temps, Roland Barthes aurait adopté comme autant de variantes du plaisir du texte.
Appliquant au livre de Pierre Bayard lui-même ses principes et préceptes d’antilecture, vous serez donc parfaitement bienvenu de ne pas faire de ce livre une lecture méthodique ni suivie, mais de le survoler et de l’oublier aussitôt ou bien encore de considérer que vous en savez suffisamment sur lui par ce que Blabla vous en dit. Sans pouvoir d’ailleurs décider s’il l’a lui-même vraiment lu. Et surtout, ne croyez pas qu’il vous suffise pour cela d’aller vérifier que Pierre Bayard cite bien, page 153, ce délicieux aphorisme d’Oscar Wilde (Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer) : n’importe qui peut en effet trouver ça en feuilletant le livre dans n’importe quelle librairie !
 Enseignant, vaguement écrivain, Bruno est un être de désir inapaisable; sexuellement obsédé, il s’acharne dans une quête du plaisir effrénée, passant des cinémas porno aux boîtes à partouzes après avoir subi quelques avanies dans un camping "new-age", l’Espace du possible (le nom peut paraître trop beau pour être vrai dans un roman — espace des possibles par essence —, il est pourtant bien réel, et la description sordide et hilarante que donne Houellebecq de ce lieu de tous les délires est digne des meilleures "choses vues"). Sa mère, prise dans la dérive sectaire des mouvements post-hippies, l’avait livré tôt au sort terrible du pensionnaire victime de la violence de ses congénères, de même qu’elle a aussi abandonné son demi-frère Michel. Biologiste féru de physique quantique, rigoureusement déterministe, ce dernier est au contraire miné par le déclin de sa sexualité, enfermé dans une inaptitude radicale à laisser parler le désir.
Enseignant, vaguement écrivain, Bruno est un être de désir inapaisable; sexuellement obsédé, il s’acharne dans une quête du plaisir effrénée, passant des cinémas porno aux boîtes à partouzes après avoir subi quelques avanies dans un camping "new-age", l’Espace du possible (le nom peut paraître trop beau pour être vrai dans un roman — espace des possibles par essence —, il est pourtant bien réel, et la description sordide et hilarante que donne Houellebecq de ce lieu de tous les délires est digne des meilleures "choses vues"). Sa mère, prise dans la dérive sectaire des mouvements post-hippies, l’avait livré tôt au sort terrible du pensionnaire victime de la violence de ses congénères, de même qu’elle a aussi abandonné son demi-frère Michel. Biologiste féru de physique quantique, rigoureusement déterministe, ce dernier est au contraire miné par le déclin de sa sexualité, enfermé dans une inaptitude radicale à laisser parler le désir. 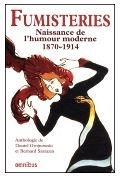 A la fin du XIXe siècle, une bande d'insolents jeunes gens vient secouer l'ordre établi. Ils se nomment les Vilains Bonshommes, les Zutistes, les Hydropathes, les Fumistes..., et fréquentent les alentours du Quartier latin et du Chat noir montmartrois. Un volcan d'inventivité fait irruption, balayant sur son passage les institutions, la famille, l'honorabilité, les poètes officiels - et même le langage. Tout est prétexte à fantaisie, parodie et sarcasme.
A la fin du XIXe siècle, une bande d'insolents jeunes gens vient secouer l'ordre établi. Ils se nomment les Vilains Bonshommes, les Zutistes, les Hydropathes, les Fumistes..., et fréquentent les alentours du Quartier latin et du Chat noir montmartrois. Un volcan d'inventivité fait irruption, balayant sur son passage les institutions, la famille, l'honorabilité, les poètes officiels - et même le langage. Tout est prétexte à fantaisie, parodie et sarcasme.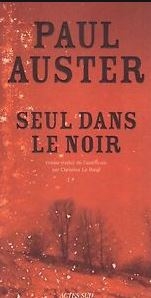 C’est ainsi que débute l’histoire d’August Brill, septuagénaire bloqué dans son lit par une jambe brisée, qu’on a bien failli amputé. Veuf depuis près d’un an et infirme, il est retourné vivre avec sa fille et sa petite-fille. Comme il le dit lui-même, c’est la maison des âmes brisées. August Brill ne se remet pas du décès de l’amour de sa vie, sa fille Miriam n’arrive pas à oublier un divorce déjà vieux de cinq ans et Katya, la petite-fille, a arrêté d’être heureuse le jour où son fiancé a été assassiné en Irak.
C’est ainsi que débute l’histoire d’August Brill, septuagénaire bloqué dans son lit par une jambe brisée, qu’on a bien failli amputé. Veuf depuis près d’un an et infirme, il est retourné vivre avec sa fille et sa petite-fille. Comme il le dit lui-même, c’est la maison des âmes brisées. August Brill ne se remet pas du décès de l’amour de sa vie, sa fille Miriam n’arrive pas à oublier un divorce déjà vieux de cinq ans et Katya, la petite-fille, a arrêté d’être heureuse le jour où son fiancé a été assassiné en Irak.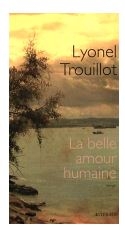 Dans son magnifique Yanvalou pour Charlie (disponible aujourd'hui en collection Babel), un brillant avocat Haïtien, Mathurin, se trouve plongé dans une aventure au sein de la pauvreté et de la délinquance, au parfum d'un passé qu'il espérait oublier à jamais. Mathurin y retrouve sa haine enfouie pour le milieu qu'il incarne lui-même aujourd'hui.
Dans son magnifique Yanvalou pour Charlie (disponible aujourd'hui en collection Babel), un brillant avocat Haïtien, Mathurin, se trouve plongé dans une aventure au sein de la pauvreté et de la délinquance, au parfum d'un passé qu'il espérait oublier à jamais. Mathurin y retrouve sa haine enfouie pour le milieu qu'il incarne lui-même aujourd'hui. Quatre ans après
Quatre ans après