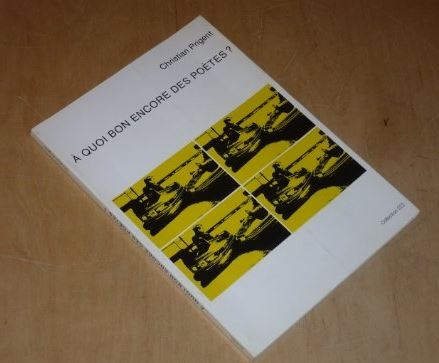
Loin de faire un éloge seul de l’art littéraire, l’auteur expose ici sa vision des choses. Et cela commence fort « comme tout monde humain, mais plus qu’aucun autre peut-être, notre monde est un monde en manque de sens. La demande de sens y est donc d’autant plus acharnée. » Et, par quoi passerait donc cette sens-ibilité ? La poésie, en tentant de « trouver une langue » est le pilier de cette quête, mais n’amène pas forcément au sens, plutôt à la Vérité. Par ses formes, sa rhétorique, son style, elle est un condensé « d’in-signifiance », soit parce que l’éclatement des formes contemporaines renvoie à l’implosion de notre monde humain (manque de stabilité, de repères) et donc que la poésie prend forme dans l’informe (« le reflet esthétisé de cette chute [du monde] en sa déclinaison lisible »), soit parce que la poésie saisit le présent, par définition flou, incertain ; qu’il faut symboliser : la poésie prend donc ici toute sa consistance.
Pour finir, Christian Pringent rappelle qu’« en France, on aime beaucoup la poésie qu’on ne lit pas. Comme on n’en lit presque pas, l’amour est immense ». Un appel à découvrir cet art, qui menaçant de disparaître à chaque instant, ne cesse de renaître sous des formes nouvelles.
Christian Pringent A quoi bon encore des poètes ? P.O.L 1996, 55 pages
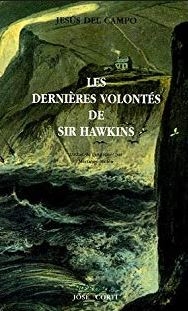 Sir Hawkins, homme qu’on devine dans la force de l’âge, s’est retiré, au bord de la mer, quelque part en Angleterre, dans l’auberge de l’Amiral Benbow qu’il a décidé de reprendre. Là, il vit avec sa gouvernante et cuisinière Mrs. Collins. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et « la silhouette torve du Corse dont tout le monde parle » s’apprête à assombrir le paysage temporel. Cela n’empêche pas notre sir de s’intéresser à ce « savoir nouveau en ébullition en France, susceptible de transformer radicalement les pensées de tous les hommes ».
Sir Hawkins, homme qu’on devine dans la force de l’âge, s’est retiré, au bord de la mer, quelque part en Angleterre, dans l’auberge de l’Amiral Benbow qu’il a décidé de reprendre. Là, il vit avec sa gouvernante et cuisinière Mrs. Collins. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et « la silhouette torve du Corse dont tout le monde parle » s’apprête à assombrir le paysage temporel. Cela n’empêche pas notre sir de s’intéresser à ce « savoir nouveau en ébullition en France, susceptible de transformer radicalement les pensées de tous les hommes ».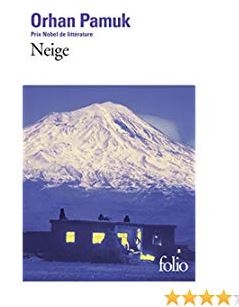 Neige est un roman hors pair, passionnant d'un bout à l'autre, un chef d’œuvre de la part d'un très grand écrivain devenu aujourd'hui incontournable et qui reçu récemment le Prix Nobel de littérature 2006. Orhan Pamuk a été défini par le Comité Nobel comme un écrivain "qui à la recherche de l'âme mélancolique de sa ville natale a trouvé de nouvelles images spirituelles pour le combat et l'entrelacement des cultures". Neige illustre parfaitement ce propos.
Neige est un roman hors pair, passionnant d'un bout à l'autre, un chef d’œuvre de la part d'un très grand écrivain devenu aujourd'hui incontournable et qui reçu récemment le Prix Nobel de littérature 2006. Orhan Pamuk a été défini par le Comité Nobel comme un écrivain "qui à la recherche de l'âme mélancolique de sa ville natale a trouvé de nouvelles images spirituelles pour le combat et l'entrelacement des cultures". Neige illustre parfaitement ce propos. L’importance du travail philosophique de Gilles Deleuze en interdit un résumé trop rapide. Nous pouvons toutefois souligner, dans l’ensemble de ses
L’importance du travail philosophique de Gilles Deleuze en interdit un résumé trop rapide. Nous pouvons toutefois souligner, dans l’ensemble de ses 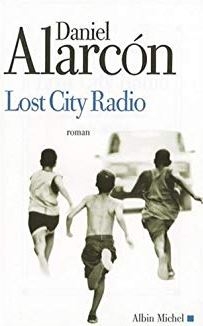 Dans un pays sans nom, où les villages ont été débaptisés et portent à présent un numéro, Norma est la présentatrice vedette d’une émission de radio à succès qui donne la parole aux auditeurs à la recherche d’un disparu. Intitulée "Lost City Radio", cette émission est la lueur d’espoir de milliers de gens déracinés, détruits par dix années de guerre civile entre un gouvernement militaire qui cherche à effacer les traces du passé et une guérilla qui cherche à embrigader les habitants des villages reculés de la jungle. Lorsque Victor, un adolescent orphelin de mère qui n’a jamais connu son père, débarque à la radio avec une liste de disparus de son village numéro 1797 et qu’il demande qu’elle soit lue à l’antenne, C’est tout le passé de Norma qui remonte à la surface. Dans cette liste, en effet, figure l’un des noms de Rey, son mari, qui, membre de la guérilla, n’a jamais reparu après avoir été arrêté par les forces militaires du pays. Les trois jours que cette femme va passer avec Victor vont bouleverser sa vie. Et qu’importent les conséquences…
Dans un pays sans nom, où les villages ont été débaptisés et portent à présent un numéro, Norma est la présentatrice vedette d’une émission de radio à succès qui donne la parole aux auditeurs à la recherche d’un disparu. Intitulée "Lost City Radio", cette émission est la lueur d’espoir de milliers de gens déracinés, détruits par dix années de guerre civile entre un gouvernement militaire qui cherche à effacer les traces du passé et une guérilla qui cherche à embrigader les habitants des villages reculés de la jungle. Lorsque Victor, un adolescent orphelin de mère qui n’a jamais connu son père, débarque à la radio avec une liste de disparus de son village numéro 1797 et qu’il demande qu’elle soit lue à l’antenne, C’est tout le passé de Norma qui remonte à la surface. Dans cette liste, en effet, figure l’un des noms de Rey, son mari, qui, membre de la guérilla, n’a jamais reparu après avoir été arrêté par les forces militaires du pays. Les trois jours que cette femme va passer avec Victor vont bouleverser sa vie. Et qu’importent les conséquences…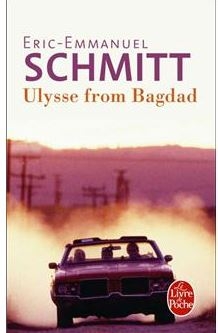 Comment parcourir des milliers de kilomètres lorsqu’on n’a pas un dinar se demande
Comment parcourir des milliers de kilomètres lorsqu’on n’a pas un dinar se demande 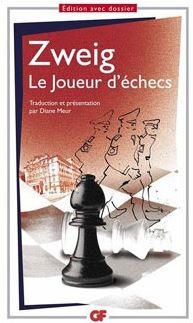 Je dois avouer que j’avais beaucoup entendu parler de cette œuvre de Stefan Zweig, et à ma grande honte, je ne m’y étais encore jamais plongé. Heureusement pour moi, grâce à cette nouvelle traduction du Livre de Poche, j’ai pu enfin me plonger dans ce grand classique.
Je dois avouer que j’avais beaucoup entendu parler de cette œuvre de Stefan Zweig, et à ma grande honte, je ne m’y étais encore jamais plongé. Heureusement pour moi, grâce à cette nouvelle traduction du Livre de Poche, j’ai pu enfin me plonger dans ce grand classique.