Tandis que paraît (en papier et en numérique) Animal du cœur de Herta Müller (prix Nobel de littérature 2009), Gallimard vient de baisser le prix de La bascule du souffle (6.99 €) un roman hors catégorie (chroniqué ici en décembre 2010) et qui a d’emblée rejoint les plus grands textes sur l’univers concentrationnaire. Ci-dessous, après reprise de mon billet, vous trouverez un extrait de ce roman. Ce chapitre, intitulé « le bonheur des camps » (où forme et fond donnent tout leur sens au projet de Herta Müller), est sans doute l’un de ceux qui m’a le plus passionné.
À noter que pour mon plus grand bonheur la littérature de langue allemande s’étoffe de plus en plus en numérique. Les auteurs classiques côtoient les contemporains, tous éditeurs confondus, avec ou sans DRM, petits prix ou non (tout est indiqué sur les fiches détail). Pour vous faire une idée, cliquez sur ce lien. Je vous rappelle que les livres numériques sont, en France, vendus au même prix partout, sur tous les sites, chez tous les revendeurs.
Pour continuer votre lecture, vous pouvez consulter le dossier consacré à Herta Müller sur le site Oeuvres ouvertes (plusieurs entretiens avec l’auteur ainsi qu’avec Nicole Bary, sa traductrice et éditrice ; discours pour la réception du Prix Nobel de littérature 2009 ; lecture par Pierre Ménard de L’homme est un grand faisan sur terre…). Un extrait du nouveau roman de Herta Müller au format ePub peut également être feuilleté en ligne ici. Je vous en reparlerai sans doute dès que je l’aurai lu.
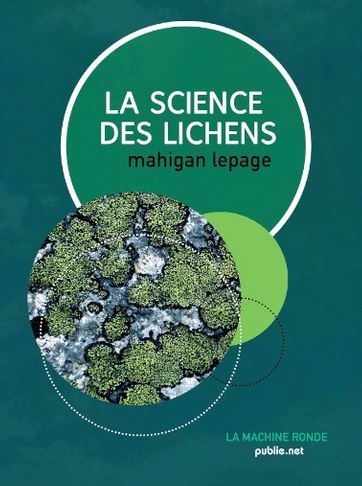 Si dans son précédent récit, Vers l’ouest, Mahigan Lepage entremêlait déplacements et projections spatio-temporels ainsi que réflexions et rencontres à travers un formidable road-movie dans les terres canadiennes (lire la chronique ici-même), cette fois, avec La science des lichens, il nous convie à d’autres « déplacements », à d’autres boucles tout en jouant avec les lignes et leurs croisements.
Si dans son précédent récit, Vers l’ouest, Mahigan Lepage entremêlait déplacements et projections spatio-temporels ainsi que réflexions et rencontres à travers un formidable road-movie dans les terres canadiennes (lire la chronique ici-même), cette fois, avec La science des lichens, il nous convie à d’autres « déplacements », à d’autres boucles tout en jouant avec les lignes et leurs croisements. 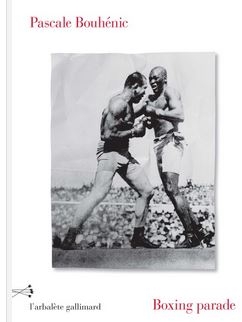 Après L’alliance (Melville, 2004) et Le versant de la joie, Fred Astaire, jambes, action (Champ Vallon, 2008), l’écrivain et réalisatrice Pascale Bouhénic publie ces jours-ci en papier et en numérique Boxing parade, un recueil nerveux et poétique sur la vie et le parcours de dix grands champions de boxe. Deux de ces récits en vers ont été publiés une première fois dans la revue Vacarme ainsi que sur le site remue.net.
Après L’alliance (Melville, 2004) et Le versant de la joie, Fred Astaire, jambes, action (Champ Vallon, 2008), l’écrivain et réalisatrice Pascale Bouhénic publie ces jours-ci en papier et en numérique Boxing parade, un recueil nerveux et poétique sur la vie et le parcours de dix grands champions de boxe. Deux de ces récits en vers ont été publiés une première fois dans la revue Vacarme ainsi que sur le site remue.net.